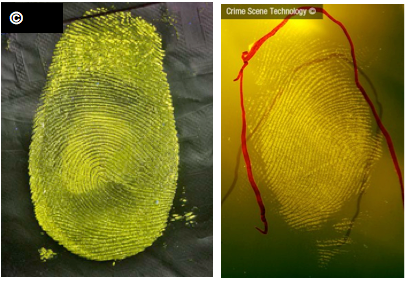La science maltraitée dans les médias ?

Changement climatique, pandémie, crise énergétique, modèle agricole… les sciences n’ont jamais pris une place aussi importante dans nos vies. Mais le traitement médiatique de la science est-il à la hauteur de l’enjeu ? Cette question était au cœur de l’émission La science CQFD sur France Culture le 5 décembre 2022, avec Sylvestre Huet et Cécile Michaut, en invités.
Si on en croit une étude qui vient de paraître, la science est plutôt bien traitée dans la presse écrite. Cependant, l’étude porte uniquement sur trois grands journaux francophones : Le Monde en France, Le Soir en Belgique et Le Temps en Suisse. Or, souligne Sylvestre Huet, il s’agit là de trois quotidiens de qualité, qui ne sont pas représentatifs des médias en général. Heureusement que la science y est importante. Mais à la télévision, la radio, ou la presse quotidienne régionale, la situation est très différente.
Le covid change la donne
Ce qui compte, c’est la manière dont la rédaction en chef considère la science, observe Cécile Michaut. Trouve-t-elle que c’est un sujet important ? En a-t-elle peur ? Néanmoins, la pandémie de Covid a peut-être changé la donne. Des journaux se sont rendus compte qu’ils ne pouvaient plus continuer sans journaliste spécialisé en science. Or, cela demande de l’expérience, notamment de comprendre comment la science fonctionne. Les résultats scientifiques sont disponibles, via les publications dans les journaux spécialisés. Le rôle des journalistes est de faire le tri.
Responsabilité des journalistes
Sur certains sujets qui impactent nos vies, la responsabilité des journalistes est énorme. « Il y a eu un véritable bombardement médiatique sur Raoult et l’hydroxychloroquine, de la part de BFM TV, qui a conduit des gens à ne pas se vacciner. Certains en sont morts, et les journalistes de ces médias ont une part de responsabilité », accuse Sylvestre Huet. Sur les sujets impliqués dans la vie de la société, sur lesquels les citoyens doivent prendre des décisions, il faut être particulièrement précautionneux.
Presse spécialisée de qualité
Le paysage médiatique français est très contrasté. La science occupe une faible part des quotidiens nationaux, une part quasi nulle dans les hebdomadaires et les quotidiens nationaux. En revanche, la presse spécialisée présente une offre riche, avec notamment la création d’un nouveau journal, Epsiloon. Mais ils touchent un public déjà conquis.
L’info de qualité coûte cher
Améliorer le traitement médiatique de la science est de la responsabilité de la hiérarchie des rédactions, mais aussi des lecteurs : une information de qualité demande du temps et coûte cher, elle ne peut pas être gratuite. Les gouvernants ont aussi leur part de responsabilité, afin de favoriser une presse compatible avec l’ambition de vivre en démocratie.
Comment l’information est-elle reçue ?
L’information de qualité existe, rappelle Cécile Michaut, mais cela ne suffit pas pour que les citoyens soient bien informés. En effet, on a tendance à refuser les informations qui nous déplaisent. Admettre l’existence du changement climatique implique de faire des efforts pour réduire nos émissions de CO2, donc il est plus agréable de nier ce changement. Les travaux de sciences sociale étudiant la manière dont les gens reçoivent l’information sont donc indispensables : comment s’informent-ils ? Comment transforment-ils l’information en action ?
Rapprocher deux mondes
Les rapports journalistes-scientifiques sont emplis de peur. Côté journalistes (non spécialisés), la crainte de ne pas comprendre. Côté scientifiques, la peur de voir ses propos déformés. D’où la nécessité de rapprocher ces deux mondes qui, paradoxalement, on des modes de fonctionnement pas si différents. Notamment la vérification des informations, cruciale pour les deux.
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-science-cqfd/sciences-decrocher-la-une-7245600
Femmes scientifiques dans les médias : le grand sexisme

En janvier 2021, les journaux ne citent qu’un quart de chercheuses, pour trois quarts de chercheurs. C’est un vrai problème, non seulement pour la place des femmes, mais aussi pour la science elle-même.
Réussir son accroche

Trop d’articles passionnants ne seront jamais lus. En cause, des titres banals, des accroches inexistantes. Pour éviter cette hécatombe, voici quelques conseils pour bien accrocher son lecteur.
Eloge de la simplicité

Une institutrice, des enfants, et quelques paillettes. Il n’en faut parfois pas plus pour mener une expérience de vulgarisation brillante.
Débuter en vulgarisation

Vulgariser vous tente, mais vous n’avez jamais osé vous lancer. Voici quelques pistes pour faire vos premiers pas. Bientôt, on ne pourra plus vous arrêter !
25 conseils de vulgarisation

En décembre, j’ai rédigé un calendrier de l’avent de la vulgarisation sur twitter. Objectif : chaque jour du 1er décembre jusqu'à noël, vous offrir une réflexion ou un conseil sur la vulgarisation. Les voici aujourd’hui compilés.
Expliquer n’est pas convaincre

Trop souvent, on pense qu’il suffit de bien expliquer la science pour que les citoyens retrouvent confiance dans les vaccins ou acceptent la réalité du changement climatique. Il n’en est rien : nos ressorts psychologiques sont bien plus complexes.
Vulgarisation ou médiation ?

Il y a les tenants de la vulgarisation, et ceux qui ne jurent que par la médiation scientifique. Au-delà des querelles de mots, ce sont deux types de relations avec le public qui s’opposent. Et s’il était possible de les réconcilier ?
Vulgarisation, un gros mot ?
Il est de bon ton, aujourd’hui, de bannir le mot « vulgarisation », au profil de « médiation ». La tare de la vulgarisation : être lié au très péjoratif « vulgaire ». Pourtant, vulgaris en latin signifiait plutôt « relatif à la foule, commun à tous ». N’est-ce pas justement l’objectif de la vulgarisation, que de rendre la science au plus grand nombre ?
Condescendance
Un autre reproche, plus fondamental : la vulgarisation serait descendante, de celui qui sait vers celui qui reçoit, avec l’aspect parfois hautain que cela implique. Au contraire, la médiatisation impliquerait d’être plus à l’écoute de l’auditoire. Il est vrai que la médiation se fait généralement en présence du public, et un médiateur scientifique qui ne serait pas attentif à son auditoire serait un bien mauvais professionnel. Faut-il pour autant remplacer « vulgarisation » par « médiation » ?
Non, car si la vulgarisation recouvre une réalité bien plus large que la médiation. Un livre, une émission de télévision, un article de journal, une vidéo font œuvre de vulgarisation, non de médiation.
Large public
Ce que la vulgarisation perd en proximité par rapport à la médiation, elle le gagne en ouverture à un large public. Certes, les centres de culture scientifiques techniques et industriels (CCSTI) comme le Palais de la découverte accueillent certes des dizaines milliers de personnes chaque année, qu’elles initient à la science. Ces personnes restent souvent marquées longtemps par ce qu’elles ont vu, et beaucoup de vocations scientifiques sont nées grâce au talent des médiateurs. Mais hormis les scolaires, ce sont souvent des personnes déjà sensibilisées à la science qui s’y rendent.
La vulgarisation, de son côté, permet parfois de toucher des centaines de milliers, voire des millions des personnes d’un coup. Elle s’adresse à tous ceux qui n’ont pas l’occasion ou l’envie de venir dans un CCSTI, ou même à ceux qui, au départ, ne s’intéressent pas du tout aux sciences.
Réconciliation
Plutôt que de continuer la querelle médiation contre vulgarisation, pour quoi ne pas s’inspirer des atouts des deux ? Par exemple en faisant de la vulgarisation moins condescendante, qui prend davantage en compte le point de vue du public. C’est ce que font la plupart des vidéastes qui demandent l’avis de leur public pour leurs prochaines vidéos, voire corrigent des erreurs ou approximations à la suite de remarques.
Métier : vulgarisateur

Partager son amour de la science avec le public : quel beau métier que celui de vulgarisateur !
Mais de quelle profession parle-t-on exactement ?
Petite revue (non exhaustive) des métiers de la vulgarisation et de leurs conditions d’exercice.
Quelles formations à la vulgarisation souhaitez-vous ?

Chercheurs, vulgarisateurs, venez donner votre avis sur les formations idéales matière de vulgarisation
Vulgariser pour mieux apprendre

Une enseignante de l’IUT d’Angoulème demande à ses étudiants de vulgariser les notions abordées. Résultat : des étudiants motivés, qui maîtrisent mieux les connaissances complexes.
La vulgarisation est un sport collectif

Rassembler des blogs ou des vidéos sur une même plate-forme, vérifier la véracité des articles, ou tout simplement s’entraider entre vulgarisateurs… c’est tout l’intérêt de la vulgarisation collaborative.
Les secrets d'une conférence réussie

Qui n’a jamais soupiré devant une conférence scientifique rébarbative ou incompréhensible ? Les colloques restent trop souvent des exercices soporifiques, d’où surnagent quelques pépites, des exposés lumineux et passionnants donnant envie de collaborer avec leur auteur.
Comment devenir un tel orateur, capable de réveiller une assemblée en pleine digestion ? Voici quelques clés.
La vulgarisation scientifique sur Wikipedia

Wikipedia fête ses 15 ans !
C'est le site qui apparaît en premier lorsqu'on cherche une information sur le web. C'est pourquoi Wikipedia ne peut pas laisser le vulgarisateur indifférent. Reste à en apprendre
les usages.
La bataille du climat se joue aussi sur la vulgarisation

Le succès ou l’échec de la COP21 se décidera bien-sûr lors des négociations entre États, mais aussi auprès du public.
Les dirigeants et leurs représentants aux négociations de la COP21 seront d’autant plus enclin prendre des décisions fortes sur le climat que leurs opinions sont conscientes des dangers du réchauffement climatique. Bien vulgariser les questions climatiques est donc un enjeu majeur, auquel se sont attelés nombre de journalistes et d’organismes. Un exercice plutôt réussi.
Des sites pour comprendre
Ainsi, le site du gouvernement sur la COP21 vient de publier une page très claire destinées à réfuter les arguments des climatosceptiques. On y rappelle que non, le réchauffement ne s’est pas arrêté en 1998, et que les variations de l’activité solaires ne suffisent pas à expliquer le changement climatique. D’autres, comme le site d’information Novethic, ont misé sur des cartes interactives, certes parfois plus difficiles à comprendre, mais utiles notamment pour appréhender les ordres de grandeur. Les amateurs de vidéos ne sont pas oubliés, avec par exemple cette superbe infographie du Monde permettant de comprendre le réchauffement en moins de 4 minutes.
Bien placés sur Google
Bien-sûr, les climatosceptiques et autres adeptes de diverses théories du complot trouveront toujours de quoi nourrir leurs fantasmes. Mais ceux qui cherchent de bonne foi des explications sur ce qu’est le climat, comment on le modélise, pourquoi on sait qu’il se réchauffe, et notre part de responsabilité, trouveront facilement de quoi satisfaire leur curiosité. En particulier, il est très positif que la première page de Google – généralement la seule consultée – lorsqu'on tape le mot "climat" ne renvoie qu’à des sources fiables comme l’incontournable Wikipedia, les articles du Monde sur le climat et la COP21, Météo France, ou Le climat en question, site créé par l’Institut Pierre-Simon Laplace (qui regroupe les principaux laboratoires de climatologie en France).
Et les télés ?
Reste à savoir si les télévisions – qui restent le média le plus consulté – seront aussi pédagogiques, et surtout à quels experts elles donneront la parole lors de la COP21. Aux vrais climatologues ? Ou aux « bons clients » médiatiques quelles que soient leurs connaissances en climatologie ? Là, le manque de journalistes spécialisés en sciences, ou ayant simplement une certaine culture scientifique risque de se faire cruellement sentir.
Cécile Michaut
Pour ou contre les PowerPoints ?

Outil de présentation utile ou désastre pédagogique ? L’utilisation de logiciels de présentation divise les enseignants et les chercheurs. Mais le recours à ces outils doit-il être banni, ou juste amélioré ?
Prenez quelques universitaires, lancez une conversation sur l’usage des PowerPoints, et vous déclenchez automatiquement des réactions passionnées. Les pro-diaporamas s’opposent vigoureusement aux anti, tandis que quelques-uns tentent de défendre un usage raisonné de ces présentations. Récemment, le chercheur Paul Ralph proposait même aux universités d’interdire l’usage des PowerPoints, tout en n’ayant aucune illusion sur le fait que son avis puisse être suivi.
Passivité
Il faut dire que les critiques envers l’usage des diapos pendant les cours, mais aussi pendant les conférences, ne manquent pas de pertinence. Passivité des étudiants, qui n’ont même plus à prendre de notes, sentiment de tout comprendre sans difficulté, lissage et simplification à outrance du discours,… les diapos seraient néfastes à l’apprentissage, mais populaires parmi les étudiants.
Soporifique
De même, nous avons tous subi lors de colloques scientifiques des PowerPoints soporifiques, remplis de courbes incompréhensibles, ou pire, de liges et de lignes de texte, servant alors d’antisèche aux conférenciers. Ces jours-là, nous aurions bien cloué au pilori les inventeurs et les utilisateurs de ces logiciels maléfiques !
Capter l’attention
Si l’on est tous d’accord pour déplorer les mauvais PowerPoints, existe-t-il un bon usage de cette technologie ? Autrement dit, l’utilisation des diapos est-elle néfaste en soi ? Pour la climatologue Valérie Masson-Delmotte, ces diapos sont un piège : « ça réduit l’attention des gens, l’écran les capte au détriment de ce que l’on dit »[1]. De même, le physicien Etienne Klein est un adepte de la pédagogie « à l’ancienne », en regardant l’auditoire dans les yeux, et en expliquant avec les mots et les mains.
Présentations bluffantes
D’autres, comme le consultant-formateur Jean-Philippe Déranlot, pensent au contraire que les PowerPoints sont un magnifique outil, à condition de bien les utiliser. Normal, puisqu’ils vendent des formations à ce logiciel ! Et en effet, certaines présentations sont bluffantes. Les diapos permettent aussi de montrer tout ce qui ne peut pas être expliqué avec des mots : cartes, courbes, images scientifiques…
Et prezi ?
Bien sûr, j’entends déjà ceux qui ne jurent que par le concurrent de PowerPoint, le logiciel Prezi, qui permet de zoomer et dézoomer sur une seule grande image. Mais là encore, l’attention de l’auditeur peut se focaliser sur l’image au détriment de vos propos. Bref, la question ne serait pas tant de bien ou mal utiliser ces techniques, que de l’utilité même de ces techniques. Peut-être le succès du concours Ma thèse en 180 secondes tient-il en partie à l’obligation de n’utiliser qu’une seule diapositive, donc de peaufiner d’autant plus sa présentation orale.
Inconditionnel ou détracteur ?
Et vous, quelle est votre utilisation de PowerPoint, Prezi, ou d’autres outils de ce type ? Etes-vous un inconditionnel de ces logiciels, ou préférez-vous les présentations « à l’ancienne » ? Comment concevez-vous vos présentations, et la complémentarité entre ce que vous montrez et ce que vous dites ?
Cécile Michaut
[1] Citée dans Vulgarisation scientifique, mode d’emploi, EDPSciences, 2014.
Dix bonnes raisons de vulgariser

Pourquoi vulgariser ? C’est un sujet que j’ai déjà traité, car il me tient à cœur. Mais aujourd’hui, je souhaite lancer un débat et recueillir vos témoignages. Pourquoi vulgarisez-vous ? Pourquoi cela vous semble-t-il important, ou au contraire, une perte de temps ? Quelle sont les raisons profondes qui vous font parfois braver le scepticisme voire la réprobation de vos collègues, pour partager vos connaissance avec des non-experts. J’ai ici recensé dix motivations, il en existe sûrement plein d’autres !
Impliquez, c’est gagné

Vous désespérez d’intéresser votre public, vos lecteurs ? Laissez-moi vous livrer une astuce infaillible : les impliquer !
On apprend mieux en étant actif qu’en recevant passivement un savoir, c’est une évidence. Pourtant, trop de vulgarisation reste basée sur le modèle d'un cours magistral vers un public passif qu'il faut abreuver de sciences. Dommage !
Un de mes plus beaux souvenirs de vulgarisation vient d’Angleterre. Je travaillais alors à la Royal Institution, un vénérable organisme qui a notamment accueilli Michael Faraday au 19ème siècle. Ce grand physicien et grand vulgarisateur a notamment créé les "Christmas Lectures", des conférences à destination du grand public. Celles-ci sont aujourd'hui retransmises à la télévision britannique, et les gens viennent y assister en smoking et robe du soir !
La Royal Institution accueillait régulièrement des enfants pour leur présenter des notions scientifiques. Je me souviens encore de ce professeur assis sur une immense balançoire pendue au plafond de l’amphithéâtre, tandis qu’un élève chronométrait sa fréquence de balancement. Je me souviens surtout de l’enthousiasme des élèves lorsque le professeur demandé qui voulait venir à sa place sur la balançoire ! Et je suis certaine que ces enfants ont bien mieux retenu le message scientifique sur la fréquence des pendules que s’ils avaient seulement assisté à un banal cours sur ce sujet.
De même, les expositions scientifiques dans lesquels le public peut toucher, manipuler, tester, expérimenter, sont bien plus efficaces que les horribles expositions uniquement sous forme de panneaux que l’on voit encore trop souvent.
Bien-sûr, impliquer est plus facile lorsqu’on réalise une expérience devant le public, mais rien ne vous empêche de faire intervenir votre auditoire lors de vos conférences, le faire participer à des petites « manips » express, ou même d’interpeler le lecteur dans vos livres et articles, comme je le fais moi-même ici.
Impliquer le public, c’est parfois même faire contribuer à la construction du savoir scientifique. C’est la belle aventure de la science participative, qui fera l’objet d’un prochain billet de blog.
Et vous, comment impliquez-vous votre public ? N’hésitez pas à partager vos expériences !
Cécile Michaut
Chercheurs et liberté d'expression

Les attentats contre Charlie Hebdo ont fait ressortir un risque méconnu : celui de l’autocensure. Si celle-ci concerne surtout les médias, elle n’épargne pas les chercheurs, dont beaucoup n’osent pas s’exprimer, surtout sur les sujets polémiques. Pourtant, la liberté d’expression des chercheurs et enseignants est particulièrement protégée.
Les chercheurs peuvent-ils s’exprimer comme ils veulent dans les médias, ou doivent-ils en référer à leur hiérarchie ? Les institutions scientifiques peuvent-elles s’arroger le droit de valider les propos de leurs chercheurs avant diffusion ? Quid de la participation des chercheurs aux réseaux sociaux ? Autant de questions qui se posent très vite à tout scientifique désireux de s’exprimer ailleurs que dans les revues spécialisées.
Sept organismes de recherche [1] viennent de publier une Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, dans laquelle un chapitre concerne la communication. Il y est notamment inscrit « la liberté d’expression et d’opinion s’applique dans le cadre légal de la fonction publique, avec une obligation de réserve, de confidentialité, de neutralité et de transparence des liens d’intérêt. Le chercheur exprimera à chaque occasion à quel titre, personnel ou institutionnel, il intervient et distinguera ce qui appartient au domaine de son expertise scientifique et ce qui est fondé sur ses convictions personnelles. La communication sur les réseaux sociaux doit obéir aux mêmes règles. »
Cette charte risque de ne pas beaucoup aider les chercheurs avides de partager leur passion avec le plus grand nombre. A aucun moment, elle n’explique ce qu’est l’obligation de réserve des fonctionnaires, qui n’a rien à voir avec une obligation de se taire ou de faire valider ses propos. Elle ne précise pas que l’obligation de confidentialité ne concerne que les travaux soumis au secret industriel ou au secret défense. L’obligation de neutralité est encore plus absconse, et pourrait faire croire que le chercheur n’a pas le droit de donner son opinion.
D’où l’utilité d’expliquer les droits et devoirs des fonctionnaires en matière d’expression publique. Rappelons-le tout de suite : à la base, il y a la liberté d’expression, affirmée par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. L’article 19 précise que « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »
Ce droit ne s’arrête pas à la porte du bureau : la liberté d’expression est garantie aussi au travail. Ainsi, pour les salariés du privé, le Code du travail précise que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » (article L1121-1). La règle de base est donc la liberté d’expression, qui comporte bien sûr des restrictions (secret industriel, obligation de loyauté envers son entreprise…) En dehors de son entreprise, le salarié jouit de sa pleine liberté d’expression, comme n’importe quel citoyen, dans la limite de la loi.
Côté fonctionnaires, ce n’est pas le code du travail qui s’applique, mais les principes sont proches. L’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise bien que « la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires ». Cette même loi ne mentionne pas le moindre devoir de réserve. Cependant, il existe un principe de neutralité de la fonction publique. Cela ne signifie pas qu’un fonctionnaire n’a pas le droit de s’exprimer ni de donner son opinion. Simplement, « le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque. » Un instituteur, par exemple, ne pourra pas faire de propagande politique ou religieuse dans sa classe. Mais en dehors de son établissement, il peut tout à fait être militant politique ou religieux !
Donc clairement, en dehors de son temps de travail, le chercheur s’exprime comme il veut, sur des sujets polémiques s’il le souhaite, il peut militer à sa guise… Qu’en est-il lorsque le chercheur s’exprime dans le cadre de ses fonctions ?
L’article L952-2 du Code de l'éducation précise que « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. » S’il est assez flou, ce texte montre néanmoins que, parmi les fonctionnaires, les chercheurs et enseignants chercheurs jouissent d’une liberté d’expression particulièrement grande.
Le Conseil constitutionnel vient renforcer cette interprétation : dans sa décision du 28 juillet 1993 sur la Loi relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel , il précise que « le statut des établissements d'enseignement supérieur ne saurait limiter le droit à la libre communication des pensées et des opinions garanti par l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen que dans la seule mesure des exigences du service public en cause ». Il ajoute que « par leur nature, les fonctions d'enseignement et de recherche exigent, dans l'intérêt même du service, que la libre expression et l'indépendance des enseignants-chercheurs soient garanties ». Libre expression garantie, on ne saurait être plus clair ! [2]
Bien-sûr, tout ne se règle pas devant les tribunaux : le fait qu’un chercheur ait le droit de s’exprimer ne signifie pas que personne ne fera pression sur lui. Notamment, les chercheurs non titulaires (doctorants, post-doctorants, ATER…) ont tout intérêt à ne pas faire de vague. D’autres craignent pour leurs crédits ou leur carrière. Mais ce risque est-il aussi grand que certains l’imaginent ?
Chercheurs, vous sentez-vous libre de vous exprimer comme vous le souhaitez ? Hésitez-vous à aborder des sujets polémiques ? Vous sentez-vous soutenu par votre hiérarchie dans votre volonté de communiquer ? Avez-vous déjà subi des pressions pour ne pas exprimer certaines opinions ? Votre avis m’intéresse !
Cécile Michaut
[1] Le CNRS, l’Inra, l’Inserm, la Conférence des présidents d’université, le Cirad, l’IRD et l’INRIA.
Les 5 erreurs à éviter en vulgarisation

Vous souhaitez partager votre passion des sciences avec un large public ? Excellente idée, mais avant de vous lancer, mieux vaut connaître les erreurs les plus fréquentes en vulgarisation… et les éviter
- Méconnaître le niveau de son public. Beaucoup de chercheurs, croyant s’adresser au grand public, s’adressent à des personnes de niveau bac, voire bac scientifique. Or, c’est plutôt un niveau troisième qu’il faut viser. Mais attention, ne pas surestimer le niveau de connaissance ne signifie pas sous-estimer l’intelligence de votre public. Ou, pour le dire plus crûment, ce n’est pas parce qu’ils savent en peu dans votre domaine qu’il faut les prendre pour des cons.
- Faire un cours. Non, le lecteur ou l’auditeur de votre conférence n’est pas un élève, et vous n’êtes pas son professeur. Abandonnez donc le ton professoral (souvent légèrement condescendant, même si l’on ne s’en rend pas compte), au profit d’un ton plus léger, comme dans une discussion. Essayez de connaître les motivations de votre public : souhaite-t-il s’informer ? Se cultiver ? Se distraire ? Vos propos ne seront pas les mêmes !
- Se laisser aller au jargon. Vous vous étiez promis, pourtant, que vous banniriez de votre discours tout mot ne figurant pas dans un dictionnaire, comme supercondensateur ou mitochondrie. Mais le jargon se cache aussi dans des mots qui apparaissent simples, mais n’ont pas la même signification en sciences et dans le langage courant. « Contraindre le modèle », « exprimer une protéine », ou même la « sensibilité d’un appareil » ne signifient pas grand-chose pour le public. Cependant, ce jargon est difficile à détecter, d’autant plus que le chercheur l’utilise tous les jours. La solution : soumettez vos explications à un ami non-scientifique et demandez-lui de vous arrêter dès qu’il ne comprend pas.
- Croire qu’il faut être ennuyeux pour être sérieux. « La gravité est le rempart de la sottise », affirmait Montesquieu. Pourtant, pour beaucoup de scientifiques, il est hors de question de risquer un trait d’humour, ou même une pointe de poésie lors d’une conférence ou dans un livre. Peur de dévaloriser la science, de l’ôter d’un piédestal ? Dommage, car en matière de vulgarisation, tout est permis : faire rêver, faire rire, provoquer des émotions,… la seule vraie interdiction : ennuyer le public !
- Vouloir tout dire. La science est tellement passionnante que vous avez envie de tout raconter : les dernières découvertes, leur histoire, les prouesses techniques qui ont permis ces résultats, les méthodes utilisées, etc. Mais vos interlocuteurs, eux, qu’en retiendront-ils ? Probablement très peu, et pas forcément ce que vous souhaitez. Ce n’est pas à eux, mais à vous de faire le travail de tri et de hiérarchisation. Si vous êtes capable de résumer votre conférence, votre article, voire votre livre en une seule phrase, vous avez fait presque tout le boulot.
Et pour vous, quelles sont les principales erreurs en vulgarisation ?
Cécile Michaut
Communiquer efficacement, c'est vital

Bien communiquer est parfois une question de vie ou de mort. Comme au Nigéria, où l’épidémie d’Ebola a été en partie stoppée grâce à une campagne claire et efficace.
L’épidémie d’Ebola au Nigéria est officiellement terminée, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Une réussite impressionnante, alors que d’autres pays comme le Libéria se débattent encore avec ce virus responsable de fièvres hémorragiques, mortel dans plus de la moitié des cas. Quel est le secret du Nigéria ? Selon Rue89, c’est en partie grâce à une campagne de prévention et d’information massive via les télécoms et sur Internet que le pays le plus peuplé d’Afrique s’est débarrassé d’Ebola.
Avant tout, il fallait un message clair. Qu’est-ce qu’Ebola ? Comment se transmet-il ? Ou encore comment se protéger ? Les réponses tiennent en une ou deux phrases très simples, utilisant des mots de tous les jours, et compréhensibles par tous. Des informations supplémentaires sont disponibles facilement, notamment pour les personnels de santé. Il était important également de démonter les fausses rumeurs qui se propagent parfois plus rapidement que les virus !
Ce message devait également être massivement diffusé. Dans un pays aussi grand et peu pourvu en infrastructures, avec une population aussi jeune, les médias les plus adéquats sont Internet et le téléphone. Une plateforme, Ebola Alert, a ainsi été mise en place, et les informations largement relayées sur les réseaux sociaux. Plus percutant encore, une application pour smartphones décrivait ce qu’il fallait faire ou éviter.
Bien vulgariser passe parfois par un geste simple et symbolique, comme celui de Barack Obama enlaçant une infirmière américaine guérie d'Ebola, afin de rappeler avec force qu'elle n'est plus contagieuse.
Bien sûr, la campagne d’information n’est pas à elle seule capable d’éradiquer une épidémie : le système de santé, la mobilisation générale du pays ont un rôle crucial. Mais une communication réussie est une condition sine qua non du succès. De quoi motiver les vulgarisateurs et communicants !
Cécile Michaut
Etes-vous encouragés à vulgariser ?

Et si notre capacité à vulgariser dépendait aussi de nos collègues ? D’après Cédric Villani, médaille Fieds et grand vulgarisateur, l’environnement professionnel est crucial pour développer le goût de la vulgarisation.
« L’Ecole nationale supérieure de Lyon, où j’ai mené la majorité de mes recherches, est un des endroits les plus en pointe en pédagogie et en vulgarisation. J’ai assisté à des conférences de grands vulgarisateurs, comme Etienne Ghys, auteur d’un DVD sur les dimensions en mathématiques, avec de nombreuses animations. Et surtout, l’esprit général encourageait à vulgariser, même en séminaire. »[1]
Un esprit absent dans d’autres lieux de recherche, où l’on préfère rester entre spécialistes. « Même à l’époque d’Internet, la culture est différente selon les lieux de recherche, le fait d’être physiquement à tel ou tel endroit forge l’esprit différemment. La vision du rôle du chercheur envers la société n’est pas la même. Pour moi, le rôle du vulgarisateur est de montrer comment la recherche est belle, il faut surtout éviter de faire la morale. »
Et vous, votre environnement de travail vous pousse-t-il à partager vos savoirs avec le plus grand nombre ? Ressentez-vous de la bienveillance envers ceux qui s'essaient à cet exercice difficile ? Ou vulgariser reste-t-il mal vu autour de vous ? Quels sont les facteurs qui encouragent ou découragent les chercheurs à vulgariser ?
Cécile Michaut
Propos tirés de Vulgarisation scientifique, mode d’emploi.
Pourquoi vulgariser ?

Partager vos recherches avec des non-spécialistes ne vous fera pas progresser dans votre carrière ni recevoir la considération de vos collègues. Alors pourquoi vulgariser ? A chacun ses raisons, en voici quelques unes
- Informer les citoyens, surtout sur les sujets « sensibles », depuis les OGM jusqu’au nucléaire en passant par les recherches sur les embryons, les gaz de schiste, les ondes électromagnétiques ou les études de genre.
- Montrer aux contribuables à quoi est utilisé l’argent dépensé pour la recherche.
- Faire naître des vocations : combien de personnes font aujourd’hui de la recherche grâce à une discussion avec un chercheur passionné, ou une visite, enfant, au Palais de la Découverte ?
- Faire progresser ses recherches, en prenant du recul et en se posant des questions qu’on ne s’était pas posées depuis longtemps.
- Trouver des financements. En effet, même s’il ne s’agit pas ici de vulgarisation grand public, toute demande de financement s’adresse à une commission dont les membres ne sont pas forcément de votre spécialité.
- Mais la raison principale (et sans laquelle on se lasse très vite), reste le plaisir de partager sa passion de la science avec le plus grand nombre.
Et vous, pourquoi vulgarisez-vous ?
Cécile Michaut
Maud Scelo : « Raconter la science en suscitant de l’émotion »

L'Europe finance des recherches de haut niveau, et s'attache aussi à créer des
ponts entre les chercheurs et les médias.
Science et partage : Quelle est votre mission au sein du Conseil européen de la recherche ?
Maud Scelo : L’ERC offre des bourses à d’excellents chercheurs, pour des recherches exploratoires. Depuis sa création en 2007, 4500 bourses ont été attribuées à des chercheurs juniors, expérimentés ou seniors. Au sein du département de communication de l’ERC, notre rôle est de donner vie à ces projets et de susciter l’intérêt des médias pour ces recherches. Enfin, il s’agit aussi de montrer que l’argent des citoyens européens est dépensé à bon escient lorsque ces projets aboutissent à des résultats ou des découvertes scientifiques qui peuvent avoir un impact positif sur notre vie quotidienne. Ce travail de communication demande de gros efforts, car la science est parfois mal aimée des médias.
S&P : Comment les chercheurs interviennent-ils dans cette communication ?
MS : Les chercheurs sont plus enthousiastes que l’on croit à parler de leurs recherches et ils sont conscients de l’importance de la communication à cet égard. Mais la culture des médias est très différente et le facteur “temps” est primordial; le temps de la science, qui est celui de la durée, de la patience, n’est pas le même que celui des médias qui fonctionnent dans l’urgence, voire dans le sensationnel. Notre objectif, c’est d’arriver à réunir ces deux mondes.
S&P : Les chercheurs ont-ils besoin d’être formés à la communication ?
MS : Oui, il y a un vrai besoin de formation. Inspirons-nous par exemple de ce qui se fait aux Etats-Unis. Là-bas, les universités misent vraiment sur la communication, et fournissent des formations clés-en-main à leurs chercheurs. L’acteur Alan Alda a même créé un centre de communication scientifique, où il propose des formations pour les étudiants, avec des matchs d’improvisation scientifique. Les chercheurs apprennent par exemple à adapter leur discours à leur audience (enfants de 10 ans, personnes âgées, etc.) avec des techniques empruntées à l’improvisation. Résultat : ils arrivent à transformer leur discours en récit et à susciter plus d’enthousiasme pour les sciences.
Il existe heureusement des initiatives de ce type en France, comme Ma thèse en 180 secondes [dont Science et partage avait parlé ici], dont la finale francophone aura lieu à Montréal en septembre, ou ailleurs les conférences TED.
Ce qui compte, au-delà de l’extraordinaire importance de la découverte scientifique, c’est la manière de raconter la science, en faisant passer de l’émotion et des expériences personnelles, plutôt qu’en faisant une conférence académique. La passion pour la science est comme une maladie infectieuse : c’est contagieux !
Propos recueillis par Cécile Michaut
Jade Le Maître : « Les réseaux sociaux sont un outil de veille et de collaboration en sciences »

Jade Le Maître est ingénieure, passionnée d’innovation et spécialiste des réseaux sociaux. Elle rêve d‘interfaces entre le web et les différents acteurs des sciences – laboratoires, instituts, universités, entreprises. Elle a été « community manager » à l’université Pierre et Marie Curie à Paris puis chez Provaltis, une agence de communication scientifique. Elle collabore à de nombreux projets liés au partage des sciences, comme Scientibox. A suivre sur twitter (@aratta) et sur www.jadelemaitre.fr
Science et partage : La science est-elle très présente sur les réseaux sociaux ?
Jade Le Maître : Pas suffisamment. Les scientifiques anglo-saxons se sont bien emparés des réseaux sociaux, mais ça commence juste en France. C’est très variable selon les thématiques : les chercheurs les plus présents sont les biologistes, les informaticiens, ainsi que les spécialistes des sciences humaines. On y trouve également des initiatives liées aux sciences, par exemple « ma thèse en 180 secondes » (hashtag[1] : #MT180 sur twitter). Mais il reste un gros travail de dédiabolisation des réseaux sociaux à faire auprès des chercheurs.
S&P : Justement, quel est l’intérêt des chercheurs à être sur les réseaux sociaux ?
JLM : Il est multiple : faire naître des collaborations, améliorer leur veille, et trouver des idées. Twitter, par exemple, est un outil extrêmement utile pour les chercheurs. Celui qui souhaite développer des collaborations suivra des chercheurs de domaines connexes, tandis que celui qui y fait sa veille s’intéressera aux chercheurs phare de son domaine.
Lorsque j’étais doctorante, je participais aux #PhDchat, une discussion entre doctorants chaque vendredi, pour parler de ses recherches et de ses difficultés. Un autre outil très efficace est Researchgate, un réseau social pour chercheurs. Il ressemble à un mélange de facebook et linkedin : le chercheur se crée un profil, se lie à d’autres scientifiques, présente ses travaux. Les institutions y sont aussi présentes, et mettent en avant leurs chercheurs phare.
S&P : les réseaux sociaux sont-ils utiles pour vulgariser ?
JLM : Oui, à condition de ne pas viser le très grand public, mais plutôt les gens déjà intéressés par les sciences, qui viendront suivre des chercheurs. Mais les réseaux sociaux ne sont pas suffisant, ils viennent en support de publications vulgarisées, par exemple des blogs de chercheurs comme ceux présents sur le C@fé des sciences[2].
S&P : Comment utiliser au mieux les réseaux sociaux lors d’un événement scientifique, par exemple un colloque ?
JLM : L’outil idéal pour cela est twitter. Il faut d’abord, définir un hashtag[1] spécifique, afin que les chercheurs soient encouragés à tweeter sur cet événement. Puis la promotion se déroule en trois phases. En amont, un « teasing » (une communication en plusieurs étapes, ménageant du suspens) permet de mobiliser les chercheurs, en complément des classiques e-mails de relance. Le jour J, il faut mettre en place un « live tweet », c'est-à-dire encourager tous les participants à tweeter en temps réel. Enfin, il faut continuer à mobiliser la communauté, toujours sur twitter, éventuellement en lien avec facebook (où on mettra par exemple un album photo de l’événement).
S&P : Avez-vous des conseils à donner aux chercheurs encore hésitants ?
JLM : N’ayez pas peur de vous lancer ! En consacrant une demi-heure à une heure par jour aux réseaux sociaux, vous deviendrez plus productif : votre boîte mail sera remplie de messages plus utiles, vous connaîtrez de nouvelles personnes, de nouveaux champs de recherche. Investissez aussi les outils spécialisés comme Mendeley qui permet de faire sa bibliographie de manière collaborative. Beaucoup de gens voient les réseaux sociaux comme un endroit où l’on raconte sa vie. Mais ce sont aussi des outils professionnels incomparables. Etre visible sur les réseaux sociaux, c’est être visible tout court.
Propos recueillis par Cécile Michaut
[1] Le hashtag, appelé aussi mot-dièse, est un marqueur sur twitter, qui permet de retrouver toutes les discussions incluant ce mot précédé d’un signe #.
[2] Sur twitter : @cafe_sciences
Quand les doctorants deviennent des stars : la thèse en vidéo

Ils ont tout compris, les doctorants rennais ! Ils veulent faire connaître leurs travaux au public, et savent que le meilleur moyen de le toucher passe par des vidéos courtes, ludiques et toniques. Ils ont donc organisé le festival Sciences en cour[t]s, où des étudiants en thèse réalisent un court métrage sur leurs travaux.
Résultat : des petits bijoux d’humour, d’énergie et de rigueur scientifique. On sent que les doctorants ont beaucoup travaillé, mais se sont surtout beaucoup amusés pour monter des scénarios plus ou moins loufoques afin de mettre en scène leur sujet de thèse sans ennuyer le spectateur.
Qu’on le regrette ou qu’on s’en réjouisse, la vidéo est aujourd’hui un moyen incomparable pour communiquer. Surtout vis-à-vis d’un public non scientifique, plus facilement rebuté par un texte, mais séduit par le côté dynamique et plus distrayant de la vidéo… qui peut pourtant apporter autant, ou même plus d’informations qu’un article !
Aujourd’hui, filmer et réaliser un montage vidéo est à la portée de tous. Le prix des caméscopes a largement baissé, et de nombreux logiciels de montage vidéo gratuits sont accessibles. La difficulté n’est pas dans la technique, maîtrisée au bout de quelques essais, mais dans la conception d’un scénario de qualité, et dans la performance du jeu des acteurs. Mais on ne demande pas aux doctorants d’être des cinéastes ou des stars de l’écran, et une petite dose d’amateurisme apporte de la fraîcheur à ces films.
Mon souhait : que ce festival se répande dans toutes les universités et tous les organismes de recherche, à l’image d’une autre initiative qui rencontre aujourd’hui un grand succès, Ma thèse en 180 secondes. Et qu’ainsi émerge une génération de scientifiques convaincus de la nécessité de vulgariser, et brillants médiateurs !
Cécile Michaut
Parlons de ce que nous ignorons

Vulgariser, d’accord, mais de quoi parler ? « De résultats », affirmeront certains journalistes scientifiques. « De la démarche scientifique », soutiendra le chercheur. « Aidez-nous à comprendre ce qui se passe aujourd’hui en science », supplieront les néophytes. « Parlez-nous des dangers des recherches », réclameront les pessimistes, tandis que les enthousiastes demanderont au contraire : « Faites-nous rêver, racontez-nous les technologies de demain ».
Dans une interview parue le 17 avril au Journal du CNRS, le neurobiologiste américain Stuart Firestein s’intéresse, quant à lui, à ce que l’on ne sait pas. Car ce que tout le monde ignore « évolue en parallèle avec la connaissance parce que chaque chose apprise ou découverte suscite de nouvelles ET de meilleures questions », observe-t-il. « Les erreurs jouent en effet un rôle fondamental en science, mais elles ne sont jamais publiées ».
A parler uniquement de ce que l’on sait, on donne l’impression d’une science figée, hautaine voire dogmatique. Pire, on transmet l’idée que la science progresse de façon continue. « Or la réalité est toute autre, constate Stuart Firestein. Nos avancées scientifiques sont faites de périodes de calme plat, de retours en arrière et de confusion. Ces épisodes de l’histoire scientifique ne sont jamais racontés. »
Il souligne aussi l’importance de s’interroger sur ce qui nous paraît évident, puisque c’est ce qui nous permet de « conserver l’ouverture d’esprit nécessaire pour explorer des territoires inconnus. » On l’a vu encore récemment avec le film de Véronique Kleiner « pourquoi les femmes sont-elles plus petites que les hommes », montrant que ce qui paraît naturel (la plus petite taille des femmes) est en fait en grande partie une construction sociale.
Dans la même veine, une nouvelle collection de livres pour enfants a récemment vu le jour. Elle s’intitule « ce qu’on ne sait pas encore » sur l’univers, les gènes ou la reproduction. Voilà qui est bien plus intéressant que l’habituelle liste de tout ce que l’on sait.
Alors peut-être que la meilleure façon de comprendre les sciences est de demander aux scientifiques de nous parler de ce qu’ils ne savent pas !
Cécile Michaut
Quand les scientifiques se mêlent de politique
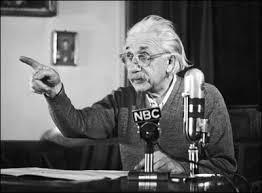
Faut-il que les scientifiques participent au débat politique ? En ces temps d'élections municipales, la question se pose. Je ne parle pas ici des chercheurs qui se présentent sur telle ou telle liste électorale, mais de ceux qui, en tant que scientifiques, souhaitent s’impliquer dans les débats citoyens.
Certains seront prompts à dénoncer un mélange des genres, et soutiendront que les scientifiques doivent rester neutres, ne surtout pas sortir de leur domaine de recherche, et que leur engagement politique doit rester secret.
Pourtant, si l’on regarde l’histoire des sciences, on s'aperçoit qu'à d'autres époques, les scientifiques ont été beaucoup plus impliqués dans la politique. Ainsi, le physicien Paul Langevin était pacifiste, président de la Ligue des droits de l’Homme, et lutta pour les mutins de la mer Noire et contre le fascisme et le nazisme. Son engagement politique ne l’empêcha pas d’être un grand scientifique et un grand vulgarisateur.
De même, Frédéric Joliot-Curie, prix Nobel de chimie en 1935 avec sa femme Irène, lança en 1950 l’appel de Stockholm pour l’interdiction de la bombe atomique, ce qui lui coûtera son poste de haut commissaire au CEA.
N'oublions pas Einstein, bien sûr, qui écrivit au président Eisenhower sur le danger que l’Allemagne nazie accède à l’arme nucléaire. Cette lettre fut probablement à l’origine du projet Manhattan aux Etats-Unis, qui se conclut par les bombes d’Hiroshima et Nagasaki. Einstein s'est constamment mobilisé politiquement, pour le pacifisme, puis contre le nazisme, et enfin contre les armes nucléaires, comme le montre ce film (voir par exemple à 28min15, et 44min42).
Aujourd’hui, les chercheurs s’engageant dans le débat politique sont beaucoup plus rares. Est-ce dû aux circonstances, moins périlleuses que pendant les deux guerres mondiales ? Ou bien les scientifiques sont-ils devenus plus frileux sur ce sujet ? Faut-il encourager les chercheurs à sortir de leurs laboratoires, ou au contraire doivent-ils rester éloignés de toute polémique ?
J’attends vos avis avec impatience !
Cécile Michaut
Où sont les vulgarisatrices ?

Il est d’usage de souligner la trop faible part des femmes en sciences, surtout lorsqu’on s’élève dans la hiérarchie. Mais encore plus rares sont les femmes scientifiques qui parlent de science dans les médias.
Les vulgarisatrices sont invisibles ! Où sont les Hubert Reeves ou Jean-Claude Ameisen au féminin ?La page de Wikipedia sur la vulgarisation ne mentionne qu’une femme parmi 20 noms, et encore s’agit-il d’une vulgarisatrice anglaise née au 18ème siècle !
Quelles sont les raisons de cette sous-représentation ? Tout d’abord, les femmes investissent peu la vulgarisation. Elles craignent d’y perdre une crédibilité durement acquise. En effet, les femmes sont considérées comme moins crédibles en sciences que les hommes, comme l’a montré une étude de l’Académie des sciences américaines.
Dans cette étude, 127 professeurs en sciences ont reçu des candidatures d’hommes et de femmes, et devaient indiquer s’ils souhaitaient les recruter, et pour quel salaire. Le résultat est saisissant : tous considèrent que les hommes sont plus compétents. Ces derniers se voient donc proposer plus souvent des postes, à des salaires plus élevés. En fait, les CV étaient fictifs et identiques, seul le sexe prénom changeait, soit féminin soit masculin. Ce biais en faveur des hommes existe même lorsque ce sont des professeurs de sexe féminin qui jugent les CV.
En quoi ce biais joue-t-il sur le fait de vulgariser ? Nous avons vu que les femmes sont « par nature » considérées comme moins compétentes. Or, il existe un préjugé tenace sur les vulgarisateurs, qui voudrait que seuls les mauvais scientifiques, ou du moins ceux qui ne sont plus capables de faire de la bonne recherche, se mettraient à vulgariser. Les femmes ne veulent donc pas cumuler un double handicap de crédibilité, en tant que femmes d’abord, en tant que vulgarisatrices ensuite !
Autre raison : la vulgarisation n’est pas encouragée par les institutions de recherche. Elle compte peu pour les promotions. Dans certains cas, elle constitue même une entrave. La plupart des scientifiques vulgarisent donc en dehors de leurs heures de travail, comme si cela ne faisait pas partie de leurs missions de chercheurs.
Mais les femmes scientifiques, comme les autres femmes, consacrent davantage de temps aux tâches ménagères et aux soins des enfants que leurs homologues masculins. Elles ont donc moins le temps rédiger un livre de vulgarisation, participer à un bar des sciences, répondre à un journaliste ou aller dans les classes.
Dernière raison, et non des moindres : les médias invitent plus facilement des hommes que des femmes en tant qu’experts.
Comme l’a souligné le collectif « prenons la une » qui milite notamment pour une juste représentation des femmes dans les médias, « dans les émissions de débat et les colonnes des journaux, les femmes ne représentent que 18 % des experts invités. » Encore une fois, un homme est « naturellement » considéré comme plus compétent qu’une femme.
Pour toutes ces raisons, les vulgarisatrices connues sont rares. Pourtant, elles existent ! L’astronaute Claudie Haigneré, la neurobiologiste Catherine Vidal, la climatologue Valérie Masson-Delmotte, ou la physicienne et philosophe Françoise Balibar ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Alors mesdames, après avoir investi les labos, introduisez-vous dans les médias. La blouse et le micro vont bien ensemble !
Cécile Michaut
« Ma thèse en 180 secondes » : un sacré défi !

Des centaines de doctorants se sont inscrits ces dernières semaines, et continuent de s’inscrire au concours « ma thèse en 180 secondes », organisé par les universités et le CNRS.
Objectif : présenter leur sujet de recherche de manière claire à destination d’un public profane, mais aussi susciter la curiosité, passionner l’auditoire pour son sujet de recherche. Et ce, en trois minutes chrono, pas une seconde de plus.
J’imagine déjà certains s’insurger contre ce concours (et contre son succès !), dénoncer une dévalorisation des savoirs, une dictature de la communication, une science « bling bling », une recherche à paillettes. Heureusement, ce genre de réaction réfutant l’intérêt même de la vulgarisation est de plus en plus rare.
L’exercice est passionnant ! Pour présenter ses recherches en trois minutes, il faut s’être longuement interrogé sur le message que l’on souhaite faire passer. Est-ce que je souhaite parler des buts de mes travaux ? De ma démarche scientifique ? De mes premiers résultats ? De l’aventure humaine que représente cette recherche ? Tout est possible, tout peut être rendu captivant.
Le doctorant doit aussi s’interroger sur le niveau de vulgarisation souhaité. D’après les organisateurs du concours, les candidats doivent « présenter leur sujet de recherche en termes simples à un auditoire profane et diversifié » Mais que connaît ce public ? A quel niveau de simplification faut-il parvenir ?
Qu’ils soient retenus ou non pour la finale du concours, tous les doctorants qui participeront à cet exercice en tireront de nombreux bienfaits. Car savoir expliquer simplement ses recherches est aujourd’hui indispensable pour démarrer dans la vie professionnelle : il faut savoir s’adresser à tous les membres d’un jury de concours, même ceux de domaines un peu éloignés.
De même, dans l’industrie, les recruteurs sont rarement des scientifiques. Savoir vulgariser sera également utile durant toute la carrière, pour décrocher des financements, attirer des étudiants, développer des collaborations avec d’autres laboratoires ou des industriels, répondre aux médias, etc.
Il existe quelques règles simples pour communiquer face à un large public : définir son message, choisir des mots simples, éviter le jargon, trouver une accroche, raconter une histoire, distiller un peu d’humour, travailler sa voix et sa posture sur scène. Car vulgariser n’est pas inné, cela s’apprend !
Cécile Michaut
Que sait le grand public ?

Une étude publiée le 14 février par la Fondation nationale des sciences américaine, et reprise par Le Monde, a ébahi nombre de lecteurs et internautes, et a été largement commenté sur les réseaux sociaux.
Selon cette étude menée auprès de 2 200 personnes aux Etats-Unis, 26 % des Américains ignorent que la Terre tourne autour du Soleil et 52 % ne savent pas que l'homme a évolué à partir d'espèces précédentes d'animaux.
Certains en ont profité pour se moquer des Américains, ignares ou contaminés par les créationnistes… Pourtant, une étude similaire menée en 2005, montrait que les Européens n’ont pas de leçons à donner : s’ils sont meilleurs sur la théorie de l’évolution (70 % admettent que l’Homme a évolué à partir d’autres animaux), ils sont 29 % à croire que le Soleil tourne autour de la Terre, et 23 % à penser que les premiers humains ont vécu conjointement avec les dinosaures. Sans parler des 46 % qui supposent que les bactéries tuent les virus, ou les 23 % qui estiment que les électrons sont plus gros que les atomes.
Vous êtes étonné par ces résultats ? C’est probablement que vous côtoyez tellement souvent des personnes cultivées que vous êtes déconnecté du niveau réel du public. Beaucoup de scientifiques, lorsqu’ils s’adressent au « grand public », imaginent une personne de niveau bac, parfois même bac scientifique.
C’est oublier que, si 80 % d’une classe d’âge décroche aujourd’hui ce précieux sésame, beaucoup sont dans des filières littéraires, économiques ou professionnelles, où la part des sciences reste faible. D’autre part, une personne qui a le bac depuis plusieurs années a oublié la plupart des connaissances qu’il n’utilise pas régulièrement. C’est pourquoi pour la plupart des vulgarisateurs, le grand public a le niveau d’un élève de troisième.
Autre erreur fréquente : croire qu’une notion scientifique utilisée fréquemment dans les médias ou les séries télévisées est comprise du grand public. Par exemple, si « Les experts » parlent d’analyse ADN sur une scène de crime, doit-on en conclure que le public sait ce qu’est l’ADN, voire connaît les méthodes d’analyse ou les informations qu’on peut tirer de ce matériel génétique ? Bien sûr que non.
Connaître son public, ce qu’il sait, ce qu’il imagine, ses envies et ses attentes, est la première étape de tout vulgarisateur. Les études sur les connaissances des citoyens sont alors une aide précieuse.
Cécile Michaut
Trois conférences en trente minutes : un succès

Belle initiative de l’université Paris-Sud et la Diagonale Paris-Saclay aujourd’hui à l’université d’Orsay : le premier « science break », un format inédit de conférences pour un large public.
Trois physiciens se relaient pour des conférences de 10 minutes chacune, basées sur des expériences. Un format court, un style dynamique, le tout suivi… d’un apéro. Bref, de quoi fidéliser ceux qui aiment les sciences mais détestent les présentations soporifiques.
Vous pensiez que le sillage des bateaux n’avait plus de secrets ? C’est aussi ce que pensaient les physiciens, depuis que Lord Kelvin, il y a plus de 100 ans, avait montré que l’angle du sillage était toujours de 19,47 degrés, quels que soient la taille et la vitesse du bateau. En demandant à ses étudiants de le vérifier par l’expérience, Marc Rabaud s’est aperçu c’était faux ! Intrigué, il a refait les expériences, et surtout, s’est appuyé sur les photos de sillages de bateaux disponibles sur Google Earth. Résultat sans appel : l’angle du sillage dépend de la vitesse du bateau.
De son côté, Wibke Drenkhan, lauréate du prix Irène Joliot-
Mais la star, c’est lui : Pioupiou, une sorte d’oiseau en bois dont les fesses sont un gros aimant, imaginé par Julien Bobroff. Ce physicien, créateur d’un groupe de recherche sur les nouveaux modes de diffusion de la recherche, veut réinventer la vulgarisation. En présentant pour la première fois son « cirque supraconducteur quantique », il a conquis l’amphithéâtre bondé de l’université d’Orsay.
« Il faut des objets rigolos et mignons pour parler de physique quantique dans les écoles », explique-t-il en nous présentant Pioupiou, le premier animal de son cirque quantique. Après avoir refroidi un cylindre en céramique supraconductrice dans l’azote liquide, il montre que Pioupiou lévite, « sans trucage » précise-t-il.
Mieux, Pioupiou suit l’aimant, comme s’il était accroché, contrairement à ce qui se passe lorsqu’on fait léviter un objet sur un jet d’air. Place ensuite à Tchoutchou, un train supraconducteur se déplaçant sur des aimants, même quand on les mets à l’envers. « C’est une démonstration en direct des propriétés étonnantes des ondes quantiques », s’enthousiasme Julien Bobroff.
Une bien belle expérience de médiation scientifique, claire et ludique. A refaire !
Cécile Michaut
Journalisme et communication scientifique : nouveaux équilibres

Lors de la journée de lancement de « Science and You », un nouveau dispositif de communication scientifique situé à Metz, Mathieu Rouault a publié une courte interview filmée de Martin Bauer, professeur à la London School of Economics, sur les rapports entre le journalisme scientifique et la communication des institutions scientifiques.
Menace ?
Son analyse est très intéressante : il existe un changement d’équilibre entre le journalisme et la communication en sciences, au bénéfice de la seconde. Or, les buts ne sont pas les mêmes : le journalisme vise à informer et participer au débat public, tandis que la communication est de valoriser l’institution. Aujourd’hui, le journalisme d’enquête, qui demande du temps, est sous pression. Ces nouveaux équilibres sont-ils une menace ? « En tout cas, ils changent l’image et la représentation de la science dans la société » conclut prudemment Martin Bauer.
Trop peu de journalistes
Cette interview rejoint ma propre observation sur l’évolution des métiers liés à la médiatisation des sciences au sens large : il existe de moins en moins de journalistes scientifiques ayant le temps de mener des enquêtes approfondies (même s’il en reste !), de plus en plus de relations publiques de qualité de la part des universités et institutions scientifiques. La tentation est alors grande, pour les journalistes ou leur hiérarchie, de reprendre les informations fournies par les institutions sans vérifier, recouper ni remettre en contexte. Bref, de ne pas faire leur métier.
La montée en puissance de la communication est, à mon avis, une bonne chose (rappelons-nous du temps où les institutions divulguaient au minimum leurs recherches). De même que le développement des centres de culture scientifique et industrielle, mais aussi des blogs de scientifiques, celle-ci ne peut pas compenser la perte de vitesse du journalisme scientifique.
Que vous soyez scientifique, communicant ou journaliste, partagez votre expérience et votre point de vue sur cette question !
Cécile Michaut
Les MOOCs vont-ils bouleverser l'enseignement ?

Les Mooc font peur
Aujourd’hui se tient à Nantes un colloque très intéressant sur les MOOCs, les massive online open courses, autrement dit des cours disponible à distance, ouverts à tous, grâce aux technologies numériques. Ces MOOCs existent déjà largement en Amérique du Nord, et les universités françaises commencent à s’y intéresser. Ils engendrent aussi beaucoup de craintes, par exemple le remplacement de professeurs par l’ordinateur pour des raisons budgétaires.
Nouvelles méthodes
Si les MOOCs se développent, ce qui est très probable, ils modifieront forcément la manière d’enseigner : un MOOC n’est pas un cours d’amphi filmé ! Pourtant, « on ne part pas de rien, le MOOC est une formation à distance, même s’il touche un grand nombre d’étudiants, a souligné Anne-Cécile Grolleau, conseillère pédagogique à l’université de Nantes, lors de la première table-ronde. Or, les recherches sur la formation à distance existent depuis 20 ans. » Néanmoins, les MOOCs posent de nouvelles questions : comment gérer plus de mille étudiants ? Comment l'étudiant construit-il son parcours ? Quid des certificats ?
Séduire
Le MOOC change le rapport enseignant-élève, rappelle Loïc Le Gac, fondateur de Thinkovery : l’étudiant n’est pas obligé de venir au cours virtuel, il apprend à son rythme, parfois dans le désordre… il faut davantage le séduire ! Le cours doit être écrit de manière spécifique, avec une scénarisation, des vidéos, des quizz, des liens vers d’autres ressources, des forums, et tout ce qui reste à inventer avec les outils numériques. D’autres métiers s’insèrent entre le professeur et les étudiants, comme des concepteurs de dispositifs pédagogiques.
Interagir
Pour Denis Gillet, maître d’enseignement et de recherche à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), « le plus révolutionnaire dans les MOOCs est le support et l’évaluation par les pairs. Il faut déléguer à une plate-forme le côté rébarbatif de l’enseignement, et davantage interagir avec les étudiants ».
Incertitudes
De nombreuses questions restent encore en suspens. Le droit d’auteur des enseignants, la protection des données des usagers, la fracture numérique (tous les étudiants n’ont pas ces usages sociaux), ou la délivrance de diplômes. Et, bien sûr, la question du financement ! Jean-Marc Nourel, fondateur d’Eduklab, cite le crowdfounding, mais l’argent peut aussi provenir de la publicité, de la vente de certificats, de produits dérivés comme les livres… Le MOOC peut aussi être un produit d’appel pour une formation plus classique. Enfin, il peut être co-construit, à la manière de Wikipedia, souligne Jean-Marie Gilliot, chef de projet MOOC à l’Institut Mines Télécom. Ils peuvent également être considérés comme un investissement en communication dans la gigantesque bagarre que se livrent les universités mondiales pour attirer les étudiants.
Malgré les questions et les inquiétudes autour des MOOCs, ce concept est réellement enthousiasmant !
Cécile Michaut
Cédric Villani : "Un politique qui vous voit dans les médias vous financera plus facilement"

Méfiance envers les journalistes
« Pourquoi perdre du temps avec des journalistes ? », se demandent beaucoup de scientifiques. Manque de temps, donc, mais aussi crainte que ses propos soient déformés, méfiance envers les médias, difficultés à expliquer simplement ses recherches,… les raisons d’ignorer la presse sont nombreuses.
Médias incontournables
Pourtant, même si les chercheurs peuvent aujourd’hui communiquer directement sur leurs travaux, via les réseaux sociaux, les blogs, les sites personnels, ou la médiation scientifique (conférences ou fêtes de la science par exemple), les médias restent incontournables dès qu’on souhaite toucher un large public.
Notoriété
« Un politique qui vous voit dans les médias vous financera plus facilement », a affirmé hier Cédric Villani au colloque « Sciences et médias – l’enjeu du numérique » organisé conjointement par la Société française de physique (SFP), la Société française de chimie (SFC), la Société mathématique de France (SMF) et la Société de mathématiques appliquées et industrielles (SMAI). A l’heure où le scientifique doit aller chercher âprement des financements pour ses recherches, négliger la possibilité de parler de vos travaux dans les journaux est une erreur !
Se former
Et si les médias vous font peur, rien ne vous interdit de vous former pour mieux vulgariser. « Un bon stage, ça change tout », soulignait Cédric Villani lors de cette conférence. Lui, si à l’aise aujourd’hui dans les médias, rappelle que sa première interview était mauvaise. Et des formations, il en existe, à commencer par celles que propose Science et partage !
Cécile Michaut
La recherche scientifique, soumise aux préjugés

Science = neutre ?
Beaucoup de gens croient que la science est par nature neutre et objective, débarrassée des préjugés. Cette science « pure » tendrait vers la découverte de réalités uniques et intangibles, et les quelques fourvoiements que l’on peut observer dans l’histoire des sciences ne seraient que des parcours rapidement corrigées par la démarche scientifique.
Idéologies
Cette image d’une science éloignée des contingences humaines en prend un coup dans ce petit film du CNRS sur les différences de taille homme-femme. En quelques minutes, il démontre que les recherches sur les origines de cette différence sont bourrées d’idéologies, qui influencent les conclusions. Tout dépend de la question posée : considère-t-on cette différence de taille comme une non-question scientifique ? Se demande-t-on s’il est normal que les hommes soient plus grands ? Ou bien pose-t-on la question autrement, par exemple « qu’est-ce qui fait que les femmes sont plus petites ? » ou encore « comment se fait-il que les femmes deviennent plus petites ? » ?
Hypothèses subjectives
« La multiplication des hypothèses de départ est toujours bien, surtout lorsque cela permet de pointer que les hypothèses précédente sont dans un cadre local, très dépendantes des croyances inconscientes de notre milieu social », souligne le philosophe Dominique Pestre. Un point de vue joliment illustré par le dessin ci-dessus !
Préjugés et ouverture d'esprit
N’oublions jamais que la recherche scientifique est une activité menée par des hommes et des femmes avec des modes de pensée qui leur sont propres, des préjugés, des idéologies… Cela ne disqualifie pas pour autant leurs travaux ! Mais cela ne peut qu’encourager les chercheurs à cultiver leur ouverture d’esprit, à étudier l’histoire des sciences (et notamment des égarements des sciences) et à s’intéresser à d’autres disciplines et d’autres modes de pensée, pour une recherche plus riche.
Cécile Michaut
Vulgariser pour progresser

Vulgarisation inutile ?
Beaucoup de chercheurs hésitent à vulgariser, car cela prend du temps, et ils ont l'impression que ça ne leur sert à rien. Certes, sauf exception, les activités de vulgarisation sont encore peu valorisées dans la carrière des chercheurs. Mais est-ce une raison pour les considérer comme inutiles ? Tous les scientifiques-vulgarisateurs avec qui j'ai discuté m'ont affirmé que communiquer autour de la science faisait progresser leurs propres recherches.
Organiser ses pensées
Cette observation rejoint les propos de Cédric Villani, mathématicien lauréat de la médaille Fields, dans une interview par des élèves du lycée français de Bruxelles et parue dans Philosophie Magazine. Il n'y parle pas de vulgarisation, mais d'enseignement. Néanmoins, les arguments sont les mêmes. "Le fait de devoir organiser ses pensées, de les synthétiser pour préparer un cours vous aide à mieux comprendre ce dont vous allez parler. Expliquer un problème fait progresser dans sa compréhension et vers sa résolution", souligne le mathématicien. "Il m’a, par exemple, été très utile de devoir expliquer mon métier à des gens qui n’y connaissaient rien. J’ai appris beaucoup de choses sur mon propre métier en les expliquant à ceux qui ne le pratiquaient pas."
Progresser dans la compréhension
Pour résumer, "Dans le processus de transmission, [le maître] remet ses pensées en ordre, il apprend, il progresse lui-même dans la compréhension." Les questions permettent aussi souvent de mettre le doigt sur un problème qu'on avait pas décelé.
Alors si vous ne vulgarisez pas pour les autres, faites-le... pour vous-même !
Cécile Michaut
Les bébé connaissent la démarche scientifique

Pas d'actu sur la médiation des sciences aujourd'hui, mais je ne résiste pas au plaisir de partager un dessin trouvé sur twitter (@SciencePorn) qui m'a fait beaucoup rire !
Cécile Michaut
De l'importance des vidéos

Incontournable vidéo
Les vidéos sont aujourd'hui incontournables dans la communication scientifique. Alvin Stone, un responsable de communication d'un centre australien sur les sciences du climat, le souligne une fois de plus dans un article relatant la couverture médiatique d'une expédition scientifico-touristique en antarctique, qui avait fait polémique.
Davantage partagées
"Les responsables de l'expédition avaient apporté de nombreuses caméras", souligne Alvin Stone. Les vidéos étaient largement diffusées sur les réseaux sociaux. "Un des bateaux de sauvetage comportait un journaliste et un photographe d'un des principaux journaux australiens, mais ils n'ont joué pratiquement aucun rôle dans la couverture médiatique de l'expédition, malgré la publication chaque jour d'articles et de photos du navire secouru". Qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, les vidéos sont bien plus partagées que les articles ou photos, quelle que soient les qualités de ces dernières.
Filmer devient facile
Il serait d'autant plus dommage de passer à côté d'un tel média que les caméras sont aujourd'hui de qualité, pour des prix raisonnables et faciles à manipuler. Celles prises avec les dernières générations de smartphone, notamment, sont parfois bluffantes !
Certains organismes de recherche l'ont bien compris, comme le CNRS, qui organise un concours "ma thèse en 180 secondes" pour encourager les doctorants à présenter leur sujet de thèse de manière claire et convaincante en 3 minutes. Certes, cela n'est pas nécessairement filmé, mais les jeunes chercheurs ainsi formés n'auront pas peur des caméras, et se lanceront plus facilement dans la communication scientifique par vidéo. De même, l'université Paris-Sud lance un concours vidéo "Filme ta fac" jusqu'au 31 janvier.
Scientifiques, à vos caméscopes !
Cécile Michaut
Quand un physicien se transmute en vulgarisateur

Quitter la recherche
Il est rare qu'un scientifique abandonne la recherche, et encore plus rare lorsque qu'il y renonce pour s'adonner à la vulgarisation. C'est pourtant ce que vient de faire le physicien Julien Bobroff, auquel Le Monde consacre un article dans l'édition du 15 janvier. Car vulgariser est encore souvent considéré au mieux comme un passe-temps pour chercheurs médiocres, au pire comme un moyen de se pousser du col.
Innover
Mais Julien Bobroff n'abandonne pas ses première amours pour faire de la vulgarisation à l'ancienne. Il souhaite avant tout développer de nouveaux modes de médiation, pour toucher un public d'indifférents à la science.
Dans une interview qu'il m'avait donnée en 2011, à l'occasion de l'année de la supraconductivité, il soulignait combien les gens avaient une image fausse de la science, celle d’une activité effectuée par des vieux messieurs un peu farfelus. Vulgariser, c’est aussi casser cette image, montrer que la science est faite aussi (surtout ?) par des jeunes. « J’ai parfois plus de questions sur les chercheurs que sur la physique. Les gens sont étonnés de voir qu’un chercheur peut être jeune, porter un jean, ou même… être une chercheuse. »
En vulgarisation comme en sciences, il faut innover, trouver les modes de partage des connaissances qui conviennent le mieux à chacun, et surtout... s'amuser !
Cécile Michaut
Communication des sciences : l'exception française
Communique-t-on différemment sur les sciences en France et aux Etats-Unis ? Clairement, oui, d'après le chercheur Sylvain Deville qui a connu les laboratoires de Californie avant de décrocher un poste au CNRS. Dans un article (en anglais) sur son site, il dissèque le manque d'intérêt des chercheurs français pour communiquer.
S'il déplore la tendance à survendre certaines recherches aux Etats-Unis, où la communication est reine, il regrette que les chercheurs français aient l'attitude inverse, beaucoup pensant que "si la science est bonne, les gens remarqueront mon travail". Il est lucide sur la qualité de nombreux sites web de laboratoires : "l'état de nombreux sites web de laboratoires, par exemple, est un bon exemple de l'actuel intérêt (ou plutôt, de l'absence d'intérêt) des chercheurs français pour la communication", note-t-il.
Certes, la situation évolue quelque peu, notamment parce qu'une nouvelle génération de chercheurs, née avec Internet, accède aux laboratoires. Néanmoins, il reste beaucoup à faire pour que de bons résultats scientifiques ne soient pas sabotés par des mauvaises présentations.
Ma propre expérience de journaliste scientifique rejoint le point de vue de Sylvain Deville. Même si de nombreux scientifiques français m'accordent du temps et m'expliquent leurs travaux, j'ai souvent plus de facilités à joindre un grand ponte anglo-saxon qu'un chercheur français. Dommage !
Cécile Michaut
Culture scientifique et technique : dans quel but ?

Le rapport que la députée Maud Olivier vient de publier avec le sénateur Jean-Pierre Leleux sur la culture scientifique, technique et industrielle (CST) fera sûrement couler moins d'encre que celui qu'elle a écrit sur la lutte contre le système prostitutionnel. Et pourtant, ce rapport mérite qu'on s'y attarde, car il est symptomatique de la vision de nos élites sur les rapports entre la science et les citoyens.
Certaines phrases mettent du baume au coeur de l'amateur de science et de culture scientifique. Les auteurs rappellent que "les actions de médiation font clairement partie des missions imparties par le législateur aux chercheurs." Voir écrit noir sur blanc que parmi les missions du personnel de la recherche figure "la diffusion de l’information et de la culture scientifique et technique dans toute la population" ne peut que renforcer le journaliste scientifique dans ses efforts constants obtenir des informations de chercheurs.
Mais quel est le but de cette culture scientifique et technique ? Il s'agit de "tirer les leçons de l’opposition récurrente d’une fraction du public à l’encontre des technologies émergentes : OGM, antennes-relais, nanotechnologies, biologie de synthèse et gaz de schiste" (p. 162). Autrement dit, la culture scientifique doit servir à faire accepter des technologies aujourd'hui décriées !
Les auteurs ne tirent aucune leçon de l'échec des débats nationaux sur les nanotechnologies ou le nucléaire. Pensaient-ils vraiment que ce type de débats destinés à entériner des décisions déjà prises pouvaient faire évoluer les opinions ? Visiblement, oui : "La question se pose en effet de savoir pourquoi, malgré la multiplication des dispositifs de débat public, existe une opposition persistante aux technologies dans plusieurs domaines, qui fait échec aux tentatives de débat apaisé."
Ce rapport confond totalement la science et la technologie. La science est avant tout une démarche reposant sur un ensemble d’observations, d’expérimentations et de théories. Elle repose sur le doute constructif, et n’est en aucun cas pro- ou anti- technologies. En revanche, elle peut étudier les bénéfices, les risques et les incertitudes de ces technologies. Les études scientifiques peuvent donner naissance de vrais débats contradictoires. Exactement le contraire de ce que font les promoteurs des technologies citées, puisque la plupart des industriels refusent de mettre sur la place publique leurs données scientifiques. Comment débattre des gaz de schiste si la composition des fluides envoyés dans le sous-sol est secrète ? La plupart du temps, l’attitude opaque des pro-technologies est donc anti-scientifique.
Oui, la culture scientifique et technique pour tous doit être davantage promue. Mais elle ne doit pas servir de propagande en faveur de telle ou telle technologie.
Cécile Michaut
Science élitiste contre science collective

Beau comme une image

2014, année internationale de la cristallographie

Vulgarisateurs américains : y'a du boulot !
Selon une étude américaine, 33 % des Américains pensent que les êtres vivants ont été créés tels qu'ils sont aujourd'hui. Et parmi ceux qui admettent l'évolution, une petite moitié pense qu'elle est le résultat d'un guide suprême. Autrement dit, seuls 32 % des Américains sont d'accord avec la théorie de l'évolution.
Vulgarisateurs américains, vous avez du boulot, contre la méconnaissance des sciences, mais surtout contre la désinformation !
Cécile Michaut
Peut-on censurer au nom de la science ?
Je profite du bilan que fait le journaliste Pierre Barthélémy, auteur du blog Passeur de Sciences, sur ses articles les plus lus en 2013 pour revenir sur son article très intéressant du 26 septembre dernier intitulé "peut-on censurer au nom de la science ?".
Il y analyse la décision du site Popular Science, un monument de la vulgarisation scientifique, de désactiver les commentaires des articles. Pour éviter les trolls, les lobbyistes, les "marchands de doute", les créationnistes,... bref, tous ceux qui ne jouent pas le jeu scientifique et font preuve de mauvaise foi, voire de malhonnêteté.
Pierre Barthélémy, tout en comprenant la décision de Popular Science, a décidé de ne pas censurer, mais de modérer a priori les commentaires pour éviter la désinformation sur son blog.
Cécile Michaut
Lever la tête du guidon
Le Huffington post est décidément très à la pointe de la vulgarisation scientifique (à moins que la science ne serve surtout à boucher le manque d'actualité et de journalistes en période de fête !). Une réflexion intéressante sur la nécessité de lever la tête du guidon lorsqu'on fait de la recherche, car certes, "pour produire des données, il faut se transformer en fourmi, non pas en aigle. La tête dans le terrier, dans le guidon, dans le sable, dans le moteur. Répéter, confirmer, contrôler, refaire", souligne l'auteur de l'article, Alexandre Stipanovich. Mais il faut aussi garder "la saveur nécessaire de la rêverie, cette faculté de créer et de dessiner des concepts." Car ce sont les concepts qui "donnent envie d'avancer".
Cécile Michaut
La vulgarisation scientifique sur Wikipedia

Wikipedia fête ses 15 ans !
C'est le site qui apparaît en premier lorsqu'on cherche une information sur le web. C'est pourquoi Wikipedia ne peut pas laisser le vulgarisateur indifférent. Reste à en apprendre
les usages.
La bataille du climat se joue aussi sur la vulgarisation

Le succès ou l’échec de la COP21 se décidera bien-sûr lors des négociations entre États, mais aussi auprès du public.
Les dirigeants et leurs représentants aux négociations de la COP21 seront d’autant plus enclin prendre des décisions fortes sur le climat que leurs opinions sont conscientes des dangers du réchauffement climatique. Bien vulgariser les questions climatiques est donc un enjeu majeur, auquel se sont attelés nombre de journalistes et d’organismes. Un exercice plutôt réussi.
Des sites pour comprendre
Ainsi, le site du gouvernement sur la COP21 vient de publier une page très claire destinées à réfuter les arguments des climatosceptiques. On y rappelle que non, le réchauffement ne s’est pas arrêté en 1998, et que les variations de l’activité solaires ne suffisent pas à expliquer le changement climatique. D’autres, comme le site d’information Novethic, ont misé sur des cartes interactives, certes parfois plus difficiles à comprendre, mais utiles notamment pour appréhender les ordres de grandeur. Les amateurs de vidéos ne sont pas oubliés, avec par exemple cette superbe infographie du Monde permettant de comprendre le réchauffement en moins de 4 minutes.
Bien placés sur Google
Bien-sûr, les climatosceptiques et autres adeptes de diverses théories du complot trouveront toujours de quoi nourrir leurs fantasmes. Mais ceux qui cherchent de bonne foi des explications sur ce qu’est le climat, comment on le modélise, pourquoi on sait qu’il se réchauffe, et notre part de responsabilité, trouveront facilement de quoi satisfaire leur curiosité. En particulier, il est très positif que la première page de Google – généralement la seule consultée – lorsqu'on tape le mot "climat" ne renvoie qu’à des sources fiables comme l’incontournable Wikipedia, les articles du Monde sur le climat et la COP21, Météo France, ou Le climat en question, site créé par l’Institut Pierre-Simon Laplace (qui regroupe les principaux laboratoires de climatologie en France).
Et les télés ?
Reste à savoir si les télévisions – qui restent le média le plus consulté – seront aussi pédagogiques, et surtout à quels experts elles donneront la parole lors de la COP21. Aux vrais climatologues ? Ou aux « bons clients » médiatiques quelles que soient leurs connaissances en climatologie ? Là, le manque de journalistes spécialisés en sciences, ou ayant simplement une certaine culture scientifique risque de se faire cruellement sentir.
Cécile Michaut
Quand les doctorants deviennent des stars : la thèse en vidéo

Ils ont tout compris, les doctorants rennais ! Ils veulent faire connaître leurs travaux au public, et savent que le meilleur moyen de le toucher passe par des vidéos courtes, ludiques et toniques. Ils ont donc organisé le festival Sciences en cour[t]s, où des étudiants en thèse réalisent un court métrage sur leurs travaux.
Résultat : des petits bijoux d’humour, d’énergie et de rigueur scientifique. On sent que les doctorants ont beaucoup travaillé, mais se sont surtout beaucoup amusés pour monter des scénarios plus ou moins loufoques afin de mettre en scène leur sujet de thèse sans ennuyer le spectateur.
Qu’on le regrette ou qu’on s’en réjouisse, la vidéo est aujourd’hui un moyen incomparable pour communiquer. Surtout vis-à-vis d’un public non scientifique, plus facilement rebuté par un texte, mais séduit par le côté dynamique et plus distrayant de la vidéo… qui peut pourtant apporter autant, ou même plus d’informations qu’un article !
Aujourd’hui, filmer et réaliser un montage vidéo est à la portée de tous. Le prix des caméscopes a largement baissé, et de nombreux logiciels de montage vidéo gratuits sont accessibles. La difficulté n’est pas dans la technique, maîtrisée au bout de quelques essais, mais dans la conception d’un scénario de qualité, et dans la performance du jeu des acteurs. Mais on ne demande pas aux doctorants d’être des cinéastes ou des stars de l’écran, et une petite dose d’amateurisme apporte de la fraîcheur à ces films.
Mon souhait : que ce festival se répande dans toutes les universités et tous les organismes de recherche, à l’image d’une autre initiative qui rencontre aujourd’hui un grand succès, Ma thèse en 180 secondes. Et qu’ainsi émerge une génération de scientifiques convaincus de la nécessité de vulgariser, et brillants médiateurs !
Cécile Michaut
Que sait le grand public ?

Une étude publiée le 14 février par la Fondation nationale des sciences américaine, et reprise par Le Monde, a ébahi nombre de lecteurs et internautes, et a été largement commenté sur les réseaux sociaux.
Selon cette étude menée auprès de 2 200 personnes aux Etats-Unis, 26 % des Américains ignorent que la Terre tourne autour du Soleil et 52 % ne savent pas que l'homme a évolué à partir d'espèces précédentes d'animaux.
Certains en ont profité pour se moquer des Américains, ignares ou contaminés par les créationnistes… Pourtant, une étude similaire menée en 2005, montrait que les Européens n’ont pas de leçons à donner : s’ils sont meilleurs sur la théorie de l’évolution (70 % admettent que l’Homme a évolué à partir d’autres animaux), ils sont 29 % à croire que le Soleil tourne autour de la Terre, et 23 % à penser que les premiers humains ont vécu conjointement avec les dinosaures. Sans parler des 46 % qui supposent que les bactéries tuent les virus, ou les 23 % qui estiment que les électrons sont plus gros que les atomes.
Vous êtes étonné par ces résultats ? C’est probablement que vous côtoyez tellement souvent des personnes cultivées que vous êtes déconnecté du niveau réel du public. Beaucoup de scientifiques, lorsqu’ils s’adressent au « grand public », imaginent une personne de niveau bac, parfois même bac scientifique.
C’est oublier que, si 80 % d’une classe d’âge décroche aujourd’hui ce précieux sésame, beaucoup sont dans des filières littéraires, économiques ou professionnelles, où la part des sciences reste faible. D’autre part, une personne qui a le bac depuis plusieurs années a oublié la plupart des connaissances qu’il n’utilise pas régulièrement. C’est pourquoi pour la plupart des vulgarisateurs, le grand public a le niveau d’un élève de troisième.
Autre erreur fréquente : croire qu’une notion scientifique utilisée fréquemment dans les médias ou les séries télévisées est comprise du grand public. Par exemple, si « Les experts » parlent d’analyse ADN sur une scène de crime, doit-on en conclure que le public sait ce qu’est l’ADN, voire connaît les méthodes d’analyse ou les informations qu’on peut tirer de ce matériel génétique ? Bien sûr que non.
Connaître son public, ce qu’il sait, ce qu’il imagine, ses envies et ses attentes, est la première étape de tout vulgarisateur. Les études sur les connaissances des citoyens sont alors une aide précieuse.
Cécile Michaut
Trois conférences en trente minutes : un succès

Belle initiative de l’université Paris-Sud et la Diagonale Paris-Saclay aujourd’hui à l’université d’Orsay : le premier « science break », un format inédit de conférences pour un large public.
Trois physiciens se relaient pour des conférences de 10 minutes chacune, basées sur des expériences. Un format court, un style dynamique, le tout suivi… d’un apéro. Bref, de quoi fidéliser ceux qui aiment les sciences mais détestent les présentations soporifiques.
Vous pensiez que le sillage des bateaux n’avait plus de secrets ? C’est aussi ce que pensaient les physiciens, depuis que Lord Kelvin, il y a plus de 100 ans, avait montré que l’angle du sillage était toujours de 19,47 degrés, quels que soient la taille et la vitesse du bateau. En demandant à ses étudiants de le vérifier par l’expérience, Marc Rabaud s’est aperçu c’était faux ! Intrigué, il a refait les expériences, et surtout, s’est appuyé sur les photos de sillages de bateaux disponibles sur Google Earth. Résultat sans appel : l’angle du sillage dépend de la vitesse du bateau.
De son côté, Wibke Drenkhan, lauréate du prix Irène Joliot-
Mais la star, c’est lui : Pioupiou, une sorte d’oiseau en bois dont les fesses sont un gros aimant, imaginé par Julien Bobroff. Ce physicien, créateur d’un groupe de recherche sur les nouveaux modes de diffusion de la recherche, veut réinventer la vulgarisation. En présentant pour la première fois son « cirque supraconducteur quantique », il a conquis l’amphithéâtre bondé de l’université d’Orsay.
« Il faut des objets rigolos et mignons pour parler de physique quantique dans les écoles », explique-t-il en nous présentant Pioupiou, le premier animal de son cirque quantique. Après avoir refroidi un cylindre en céramique supraconductrice dans l’azote liquide, il montre que Pioupiou lévite, « sans trucage » précise-t-il.
Mieux, Pioupiou suit l’aimant, comme s’il était accroché, contrairement à ce qui se passe lorsqu’on fait léviter un objet sur un jet d’air. Place ensuite à Tchoutchou, un train supraconducteur se déplaçant sur des aimants, même quand on les mets à l’envers. « C’est une démonstration en direct des propriétés étonnantes des ondes quantiques », s’enthousiasme Julien Bobroff.
Une bien belle expérience de médiation scientifique, claire et ludique. A refaire !
Cécile Michaut
Les MOOCs vont-ils bouleverser l'enseignement ?

Les Mooc font peur
Aujourd’hui se tient à Nantes un colloque très intéressant sur les MOOCs, les massive online open courses, autrement dit des cours disponible à distance, ouverts à tous, grâce aux technologies numériques. Ces MOOCs existent déjà largement en Amérique du Nord, et les universités françaises commencent à s’y intéresser. Ils engendrent aussi beaucoup de craintes, par exemple le remplacement de professeurs par l’ordinateur pour des raisons budgétaires.
Nouvelles méthodes
Si les MOOCs se développent, ce qui est très probable, ils modifieront forcément la manière d’enseigner : un MOOC n’est pas un cours d’amphi filmé ! Pourtant, « on ne part pas de rien, le MOOC est une formation à distance, même s’il touche un grand nombre d’étudiants, a souligné Anne-Cécile Grolleau, conseillère pédagogique à l’université de Nantes, lors de la première table-ronde. Or, les recherches sur la formation à distance existent depuis 20 ans. » Néanmoins, les MOOCs posent de nouvelles questions : comment gérer plus de mille étudiants ? Comment l'étudiant construit-il son parcours ? Quid des certificats ?
Séduire
Le MOOC change le rapport enseignant-élève, rappelle Loïc Le Gac, fondateur de Thinkovery : l’étudiant n’est pas obligé de venir au cours virtuel, il apprend à son rythme, parfois dans le désordre… il faut davantage le séduire ! Le cours doit être écrit de manière spécifique, avec une scénarisation, des vidéos, des quizz, des liens vers d’autres ressources, des forums, et tout ce qui reste à inventer avec les outils numériques. D’autres métiers s’insèrent entre le professeur et les étudiants, comme des concepteurs de dispositifs pédagogiques.
Interagir
Pour Denis Gillet, maître d’enseignement et de recherche à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), « le plus révolutionnaire dans les MOOCs est le support et l’évaluation par les pairs. Il faut déléguer à une plate-forme le côté rébarbatif de l’enseignement, et davantage interagir avec les étudiants ».
Incertitudes
De nombreuses questions restent encore en suspens. Le droit d’auteur des enseignants, la protection des données des usagers, la fracture numérique (tous les étudiants n’ont pas ces usages sociaux), ou la délivrance de diplômes. Et, bien sûr, la question du financement ! Jean-Marc Nourel, fondateur d’Eduklab, cite le crowdfounding, mais l’argent peut aussi provenir de la publicité, de la vente de certificats, de produits dérivés comme les livres… Le MOOC peut aussi être un produit d’appel pour une formation plus classique. Enfin, il peut être co-construit, à la manière de Wikipedia, souligne Jean-Marie Gilliot, chef de projet MOOC à l’Institut Mines Télécom. Ils peuvent également être considérés comme un investissement en communication dans la gigantesque bagarre que se livrent les universités mondiales pour attirer les étudiants.
Malgré les questions et les inquiétudes autour des MOOCs, ce concept est réellement enthousiasmant !
Cécile Michaut
Cédric Villani : "Un politique qui vous voit dans les médias vous financera plus facilement"

Méfiance envers les journalistes
« Pourquoi perdre du temps avec des journalistes ? », se demandent beaucoup de scientifiques. Manque de temps, donc, mais aussi crainte que ses propos soient déformés, méfiance envers les médias, difficultés à expliquer simplement ses recherches,… les raisons d’ignorer la presse sont nombreuses.
Médias incontournables
Pourtant, même si les chercheurs peuvent aujourd’hui communiquer directement sur leurs travaux, via les réseaux sociaux, les blogs, les sites personnels, ou la médiation scientifique (conférences ou fêtes de la science par exemple), les médias restent incontournables dès qu’on souhaite toucher un large public.
Notoriété
« Un politique qui vous voit dans les médias vous financera plus facilement », a affirmé hier Cédric Villani au colloque « Sciences et médias – l’enjeu du numérique » organisé conjointement par la Société française de physique (SFP), la Société française de chimie (SFC), la Société mathématique de France (SMF) et la Société de mathématiques appliquées et industrielles (SMAI). A l’heure où le scientifique doit aller chercher âprement des financements pour ses recherches, négliger la possibilité de parler de vos travaux dans les journaux est une erreur !
Se former
Et si les médias vous font peur, rien ne vous interdit de vous former pour mieux vulgariser. « Un bon stage, ça change tout », soulignait Cédric Villani lors de cette conférence. Lui, si à l’aise aujourd’hui dans les médias, rappelle que sa première interview était mauvaise. Et des formations, il en existe, à commencer par celles que propose Science et partage !
Cécile Michaut